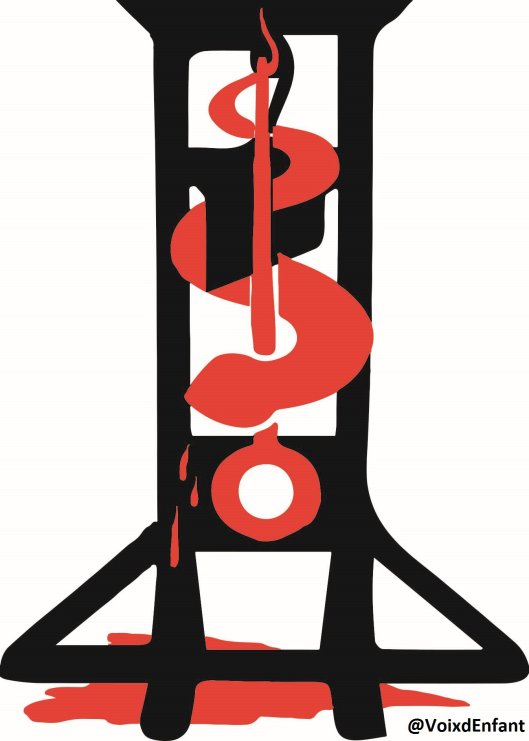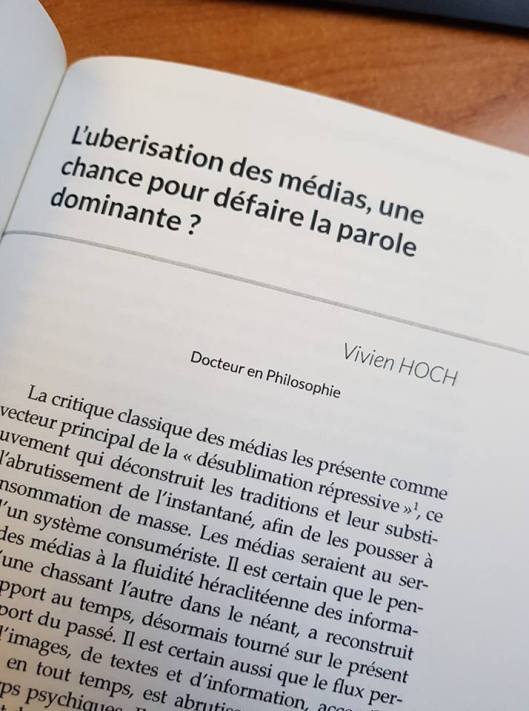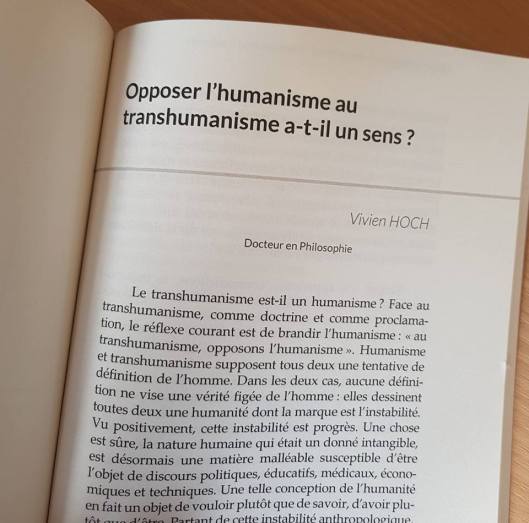Article publié dans Polemia
La devise du New York Times énonce : « Toutes les nouvelles qui méritent d’être imprimées ». Il n’y a rien de plus faux. Chaque jour, le journaliste détermine ce qui est important, ce que nous devrions savoir. Il fait le tri entre les informations et choisit la manière de les présenter.
Les journalistes des grands journaux se targuent de maîtriser leurs préjugés et de fournir une information « experte ». « Ils se voient comme les défenseurs des valeurs occidentales progressistes, nous protégeant des nouvelles qui ne méritent pas d’être imprimées, pornographie, propagande ou publicités déguisées en informations. Tels des conservateurs de musée, les rédacteurs du NYT organisent notre vision du monde », écrit Scott Galloway, professeur à la New York University, qui a été au comité de direction du New York Times[1]. « Lorsqu’ils sélectionnent les informations qui feront la une, ils établissent le programme des journaux radio et télévisés, la vision dominante de l’actualité partagée par la planète ».
Eugénisme médiatique
Cette emprise des grands médias sur l’agenda démocratique, ce dépistage des événements avant qu’ils ne naissent comme information, tout cela constitue un eugénisme médiatique. Ne naissent que les informations sélectionnées ; les autres sont écartées, supprimées, passées sous silence. C’est une ontologie de la radiographie : tout événement est transformé en fonction de l’éclairage – ou de l’obscurité – qu’on lui donne. On ne peut pas comprendre le contexte général de Fake news, sans parler des Ghost news (nouvelles fantômes), ces événements ou ces propositions (partis politiques, mobilisations, associations) délaissés par les médias nationaux, passées sous les lumières médiatiques, devenues par-là fantomatiques. Il y a pire que d’être roulé dans la boue par les médias : il y a le fait de ne même pas avoir d’existence à leurs yeux, ce qui bloque toute possibilité de participer au débat démocratique.
Au fond, comme l’écrit Umberto Eco, la télévision « parle de moins en moins du monde extérieur. Elle parle d’elle-même et du contact qu’elle est en train d’établir avec son public. »[2]. Elle tente de survivre au pouvoir d’un téléspectateur qui est devenu actif, en devant plus agressive, en parlant plus d’elle-même. Cela se traduit dans les débats TV qui commentent l’actualité : les journalistes invitent des… journalistes pour discuter des thèmes choisis par des… journalistes. Nulle part n’intervient le monde extérieur. Nulle part un micro est tendu en-dehors de la sphère médiatique. L’un des signes de la radicalisation des médias est cet enfermement sur soi-même, cet entre-soi, qui contredisent l’essence même du média – être un médiateur.
Cet enfermement médiatique remet en question profondément le fonctionnement démocratique. Le débat se déroule sur le terrain médiatique, qui est le lieu de confrontation des paroles et des vécus. Les médias vivent cette mission avec une contradiction intérieure, une double injonction. D’une part le journaliste veut rendre compte des faits le plus loyalement possible, d’autre part il se doit de respecter les versions des uns et des autres, parfois multiples et contradictoires, d’un même fait.Dans cette contradiction, le pouvoir médiatique a tranché : il est le garant de la véracité des débats parce qu’il est l’ « expert des faits ». Pour cela, il lutte contre les fausses informations : il fait de la « vérification de faits« (fact-checking). Ce qui résiste au fact-checking des médias et des experts médiatiques est qualifié de « faits alternatifs » (alternative facts). Il est vrai que le politique ne s’embarrasse pas toujours du souci la vérité,et lui préfère souvent l’efficacité et la communication : c’est le règne de la post-vérité(post-truth).
Post-vérité, faits alternatifs et fact-checking sont les nouvelles topiques du monde médiatique. Leur signification profonde et la raison pour laquelle ils sont utilisés abondamment doivent être connus et maîtrisés. Revenons rapidement sur leur signification.
La post-vérité, la vérité du monde
La notion de vérité est au cœur de notre démocratie. Elle est le terrain de manipulation de toutes les dictatures et de tous les totalitarismes, qui prétendent la posséder et l’imposer. Cette disputatio démocratique entérine le règne de la « post-vérité ». Elle est aujourd’hui toujours au cœur de la guerre sémantique que se livrent une partie du peuple et le conglomérat de médias, d’intellectuels et autres ayants-droits qui pensent pour lui. C’est surtout depuis l’apparition de Donald Trump et de ses militants que les journalistes ont commencé à parler du concept de post-vérité dans le débat politique. La post-vérité, tous les méchants la pratiquent – Donald Trump, les « populistes », les réactionnaires, les conservateurs. Le règne de la post-vérité, c’est l’apparition de personnalités qui manipulent l’opposition en exagérant les faits, en les travestissant ou encore en les imposants. C’est aussi cette masse immense de flux d’information sur les réseaux sociaux, qui échappe au contrôle des institutions et des médias classiques.
En 2016, le dictionnaire d’Oxford a désigné l’expression post-truth comme mot de l’année[3]. Elle est définit comme « relative aux circonstances dans lesquelles les faits objectifs ont moins d’influence sur la formation de l’opinion publique que l’appel aux émotions et aux croyances personnelles ». La définition est intéressante, car elle suppose qu’une objectivité des faits est possible, et que cette objectivité a une relation spécifique avec l’opinion publique. Evidemment, le constat d’une contestation contemporaine de l’existence d’une vérité absolue, soit le relativisme généralisé, n’est pas nouveau. Les « circonstances » qui font que la vérité est devenue négligeable, volatile, malléable, c’est notre culture toute entière. La post-vérité est une caractéristique de notre époque toute entière. La post-vérité est la vérité de notre monde. La Doxa, l’opinion fluide et contingente, soumise aux aléas a gagné sa bataille plurimillénaire contre le philosophe.
En liant la post-vérité à la manipulation, les théoriciens du monde moderne ne sont pas si modernes. C’est une manière finalement assez classique de comprendre le politique depuis Machiavel[4]. Mais il est intéressant de noter que la post-vérité est associée à la manipulation de l’opinion via les émotions.Ainsi peut-on lire dans les médias que l’insécurité n’est que « ressentie », suggérant implicitement qu’objectivement elle n’existe pas. On comprend pourquoi la répression judiciaire s’abat sur les –phobies – techniquement des peurs, donc des sentiments, des états émotionnels. Ces derniers deviennent des faits objectifs susceptibles d’être condamnées. Le monde du sentiment devient judiciarisable, donc contrôlable. La post-vérité est en cela une condition de possibilité du biopouvoir, qui désigne l’ensemble des techniques qui étendent leur contrôle sur la vie et les corps humains.
Les faits alternatifs (alternative fact) : la coexistence des contraires
Si on creuse l’idiosyncrasie mise en place pour décrire le règne de la post-vérité, on rencontre l’expression de « faits alternatifs ». La post-vérité, c’est l’utilisation systématique des « faits alternatifs » à des buts politiques. Le fait alternatif est plus que la possibilité de l’erreur ou la volonté de mentir : c’est la substitution coercitive d’une version des faits sur une autre. Une interprétation chasse l’autre, une version étouffe les autres versions, la coexistence des interprétations est impossible. Un fait alternatif n’est pas une erreur, c’est la possibilité ouverte qu’un fait soit autrement qu’il n’est réellement. Le concept de “faits alternatifs” veut dire non pas qu’il y a diverses interprétations, ou plusieurs versions des faits, mais désigne l’existence de faits et en même temps l’existence de la possibilité qu’il y ait d’autres faits à ceux-ci. Comme si la réalité possédait plusieurs facettes, qui coexistent au même moment, et qui sont parfois contradictoires. En 2017, la conseillère du président Trump, Kellyanne Conway, faisait référence à Nietzsche devant la presse pour justifier que les faits que voient les journalistes ne sont peut-être pas les faits que voient les gens. Selon le philosophe allemand, le réel est un jeu de forces contradictoires et mouvantes créant une multiplicité, et non une belle harmonie de «faits» identifiés et triés par « ceux qui savent ». Tout comme Nietzsche, le trumpisme détruit le piédestal de ceux qui imposent leur version des faits ; il introduit des alternatives là où on ne nous présentait que l’unilatéral et le commun.
Le fact-checking : la pharmacopée du mensonge
Chaque commentaire politique se présente avec une dimension heuristique, c’est-à-dire de recherche de la vérité. L’expert décrète la vérité des choses et des paroles. « Ceci est vrai ou faux / ce qu’il dit est un mensonge ou une vérité ». Les journalistes ont ainsi créé des cellules de riposte pour « vérifier les faits » ; autrement dit, pour dire si ce qui est dit coïncide avec leur propre version des faits, leur propre interprétation des textes et des chiffres. Ainsi les journalistes ne sont plus les rapporteurs des faits et des paroles, leur éditeurs, leurs commentateurs, mais ils sont devenus leurs juges. Les fonctionnaires du fact-checking irriguent une gigantesque pharmacopée virtuelle contre les prétendus « FakeNews ».
Selon eux, les populistes sont ainsi désignés parce qu’ils travestissent les faits afin de mentir sciemment. De nombreuses personnes accusent à leur tour les médias d’être malhonnêtes et de présenter les choses faussement. Dans cette violente dialectique, il n’y a pas de part au droit à l’interprétation. Aucune partie ne semble vouloir admettre la simple existence d’une “version des faits”. Ces parties se retrouvent souvent au tribunal, jugées à l’aune de lois souvent liberticides, qui consacrent la judiciarisation du débat public.
Les Ghost-news ou le pouvoir d’invisiblisation
Dans son histoire politique de la vérité, Michel Foucault montre « que la vérité n’est pas libre par nature, ni l’erreur serve, mais que sa production est tout entière traversée par des rapports de pouvoir »[5]. C’est le pouvoir, au sens large, qui impose sa version des faits avec toute la coercition dont il dispose : celle de la force en dernier lieu, pour le pouvoir politique, mais aussi celle de la masse, pour les médias importants, celle de l’expertise « irréfutable », pour les experts. C’est la fameuse formule de Thomas Hobbes, dans le Leviathan : « Auctoritas, non veritas facit legem – c’est l’autorité et non la vérité qui fait la loi »[6]. Alors que la force est l’autorité du politique, l’irréfutabilité est celle de l’expert, celle des médias est la visibilisation.
Quand les médias tournent en boucle sur un sujet, salissant un tel ou tel, adorant tel ou tel, la puissance est phénoménale. Quand les médias, à l’inverse, passent volontairement sous silence un événement, une initiative ou une démarche, il est quasiment mort-né.Les médias ont le pouvoir de rendre visible un événement, mais aussi de l’invisibiliser. C’est la Ghost-news.
Quelle vérité ?
On pourrait se demander quel est le concept de vérité qui fait les frais de ce dépassement (post-vérité), de la fausseté (Fake news) et du checking (factchecking). Pour le comprendre, il faut revenir à la définition pluriséculaire de la vérité – « Veritas est adaequatiorei et intellectus » – qui relève, à l’origine, de la théologie. Saint Thomas d’Aquin, dans la question 1 de son magistral De Veritate, interprète cette définition comme l’adéquation de l’intelligence divine avec les choses. Pour la créature, c’est un peu plus compliqué : ce que nous formulons des choses ne sont pas les choses. Il y a une inadéquation fondamentale, et c’est à cause de cette insuffisance gnoséologique que la vérité pleine et entière n’est pas accessible – sinon par la vie théologale – et suppose donc une perpétuelle auto-interprétation : c’est-à-dire une histoire.
L’expert et son totalitarisme interprétatif
Le problème de la vérité médiatique ne tient pas tant à l’adéquation du discours politique avec les faits, qu’à la manière dont le discours politique s’énonce et aux conditions dans lesquelles il est reçu. Les faits, lorsqu’ils sont humains – c’est-à-dire économiques, sociaux, éthiques, religieux – sont irréductibles à toute adéquation et à toute objectivité. On explique un événement physique, on comprend un événement humain. L’expertise réduit le fait humain à une explication causaliste. Sur le plateau de TV, l’expert, avec ses chiffres et son panache,pose son interprétation dans le marbre de la vérité médiatique. Il est indiscutable. Mais il ne rend pas compte de la profondeur du réel et des complexités humaines.La vérité de l’expert cache en fait un totalitarismesémantique, qui empêche toute opinion concurrente de se manifester.
***
Le média prétend donc restituer des faits objectifs sous le règne de la post-vérité, où il n’y a ni faits, ni objectivité. Il prétend confronter les interprétations, alors qu’il est un biopouvoir, où il domine et contrôle. Il prétend adresser un message à un consommateur passif et captif, alors que, déjà, les consommateurs sont actifs et libres. Les individus hypermodernes ne poursuivent plus un bien commun univoque, un récit général. Il n’y a plus de grand récit collectif, et les compteurs – les médias institutionnels – sont en retard de plusieurs pages.
Les grandes utopies qu’ils nous comptaient ne trouvent plus d’emprise sur le réel, parce qu’elles n’existent plus. Chacun poursuit désormais sa micro-utopie, et est en droit de médiatiser son vécu. L’uberisation de la prise de parole politique a définitivement éclaté les canaux habituels. Il suffit d’un smartphone pour ouvrir une chaine Youtube politique, qui a potentiellement des millions de vues ; les initiatives se sont décentralisées, les prises de parole ont abondées, le sens est devenu multiple. On assiste à la fois à l’émergence massive d’une vague d’auto-entreprenariat médiatique, où chacun s’exprime directement, et à la radicalisation des contestations du pouvoir.S’accrocher aux récits collectifs racontés par les médias institutionnels, c’est trainer les pattes derrière l’autoroute de l’histoire.
Il nous manque peut-être une rigueur personnelle qui permettrait de nous libérer de ces grands récits médiatiques. Qui nous transformerait définitivement, non plus spectateur, mais en acteur du monde.
Vivien Hoch
11/02/2019
L’article complet est en ligne sur Academia : L’uberisation des médias, une chance pour défaire la parole dominante ?
[1] Scott Galloway, Le règne des quatre, trad. Fr. Edito, 17 mai 2018, p. 172
[2] Umberto Eco, « TV : la transparence perdue », La Guerre du faux, Poche, 1985, p. 197
[3] https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2016
[4] Machiavel, Le Prince, chap. XVIII « Il faut que le prince ait l’esprit assez flexible pour se tourner à toutes choses, selon le vent et les accidents de la fortune le commandent ».
[5] Michel Foucault, La Volonté de savoir, Gallimard, 1976, p. 81
[6] Thomas Hobbes, Léviathan, trad. G. Mairet, chap. XXVI, « Des lois civiles », Paris, Gallimard (coll. « Folio Essais »), 2000 : « Dansune cité constituée, l’interprétation des lois de nature ne dépend pas des docteurs, des écrivains qui ont traité de philosophie morale, mais de l’autorité de la cité. En effet, les doctrines peuvent être vraies : mais c’est l’autorité, non la vérité, qui fait la loi. »